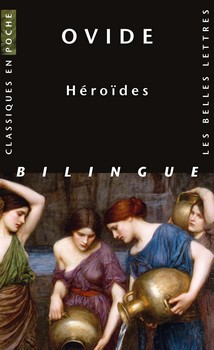
Ovide, en latin Publius Ovidius Naso[1], né en 43 av. J.-C. à Sulmo dans le centre de l’Italie et mort en 17 ou 18 ap. J.-C., en exil à Tomis (l’actuelle Constanţa en Roumanie), était un poète latin des débuts de l’Empire romain. Ses œuvres les plus connues sont L’Art d’aimer et Les Métamorphoses.
Issu d’une famille aisée des Abruzzes appartenant à l’ordre équestre, Ovide était l’héritier d’une grande fortune. Il étudia la rhétorique à Rome et, quand il eut dix-huit ans, son père lui offrit de faire un long voyage à Athènes qui le marqua et exerça une influence sur ses œuvres.
Il entra ensuite dans la carrière judiciaire, qu’il délaissa très tôt pour se consacrer à la poésie.
Artiste mondain, sensible et spirituel, il fréquenta les poètes Horace, Tibulle et Properce.
Ovide inaugura publia sa première œuvre littéraire à vingt-quatre ans, Les Amours (19 av. J.-C.), un recueil d’élégies développant des thèmes érotiques dans un roman d’amour tournant autour du personnage de Corinna, une hétaïre.
En 2 av. J.-C., Ovide apparaît comme un poète majeur du Principat (le régime instauré par Auguste), car il est choisi pour déclamer en vers l’inauguration du temple de Mars Vengeur, à Rome.
Il connaît bientôt la célébrité grâce à trois autres recueils de poèmes, les Héroïdes, l’Art d’aimer (1 av. J.-C.) et les Remèdes à l’amour (2 apr. J.-C.).
Cette inspiration, jusque-là quelque peu grivoise, change ensuite d’orientation.
Renonçant en grande partie aux distiques[2] de sa poésie amoureuse, il adopte l’hexamètre dactylique[3] dans un poème astronomique, Les Phénomènes, où, selon le témoignage de Valerius Probus, il décrit la marche des astres sur le firmament, évoquant Persée et les Pléiades.
À partir de 3 apr. J.-C. il s’applique à un calendrier national, les Fastes dans lequel il parcourt, mois par mois, le cycle annuel des fêtes religieuses romaines.
Après l’âge de quarante ans, il abandonne la poésie érotique pour écrire Les Métamorphoses, poème de 12 000 hexamètres dactyliques répartis en quinze livres et reprenant les récits de la mythologie grecque et romaine[4].

Ovide
Représenté dans la Chronique de Nuremberg (1493).
Composées entre 25 et 16 avant notre ère, les Héroïdes d’Ovide paraissent dans une version de poche actualisée aux Éditions Les Belles Lettres à Paris, fondée sur le texte établi par le grand latiniste français Henri Bornecque (1871-1935), professeur de philologie latine (1906), puis de langue et littérature latines à la faculté des lettres de Lille de 1913 à sa mort.
Il s’agit d’un recueil de quinze lettres fictives envoyées par des héroïnes malheureuses de la mythologie à l’homme qui les a délaissées (Pénélope à Ulysse, Phyllis à Démophoon, Briséis à Achille, Phèdre à Hyppolite, Œnone à Paris, Hypsipyle à Jason, Didon à Énée, Hermione à Oreste, Déjanire à Hercule, Ariane à Thésée, Canacé à Macarée, Médée à Jason, Laodamie à Protésilas, Hypermestre à Lyncée, Sapho à Phaon) auxquelles s’ajoutent les lettres de trois couples mythiques (Hélène/Pâris, Héro/Léandre, Cydippe/Acontius).
Extraits :
« Je saurais où tu combats et ne craindrais que la guerre ; et ma plainte se joindrait à beaucoup d’autres. Ce que je dois craindre, je l’ignore : cependant, affolée, je crains tout et un vaste champ s’ouvre à mon angoisse. Tout ce que l’onde, tout ce que la terre a de périls, je le soupçonne d’être la cause de si longs retards. Et tandis que, sottement, je redoute ces dangers, peut-être (quels caprices sont les vôtres !) es-tu captif d’un amour étranger. Peut-être vas-tu lui conter quelle rustique est ta femme, bonne seulement à dégrossir la laine !
Puissé-je me tromper et qu’un tel soupçon s’évanouisse dans l’air léger. Libre de revenir, puisses-tu ne pas vouloir l’absence ! » (Pénélope à Ulysse, 70-80)
« Cette image de ton départ reste fixée dans mes yeux : quand ta flotte, prête à partir, mouillait dans nos ports. Tu osas m’enlacer, et, penché sur le cou de ton amante, joindre nos bouches pendant de longs moments, confondre tes larmes et mes larmes, te plaindre que la brise fût propice à tes voiles, et, te séparant de moi, me dire cette parole suprême : “Fais en sorte, Phyllis, d’attendre ton Démophoon.»” Attendre qui est parti pour ne jamais me revoir ! Attendre des voiles que me refusent les mers ! Et néanmoins, j’attends !” » (Phyllis à Démophoon, 90-100)
« Cependant, lorsque tu me lisais, moi aussi je te paraissais belle : tu jurais qu’à moi seule il convenait de parler toujours. Je chantais, il m’en souvient (les amants se souviennent de tout) : pendant que je chantais, tu me donnais des baisers que tu me volais. Tu les vantais aussi : de tout point je te plaisais, mais principalement alors que se fait l’œuvre d’amour. Alors tu trouvais un charme plus qu’ordinaire à ma lascivité, sans cesse en mouvement, à mes propos bien adaptés à nos jeux, et lorsque nous avions ensemble confondu notre volupté, à cette langueur intense du corps fatigué.
Maintenant viennent à toi les filles de Sicile, proie nouvelle. Qu’ai-je à faire de Lesbos ? Je veux être Sicilienne ou bien vous, femmes de l’île, filles de l’île, renvoyez de votre territoire ce fugitif et ne vous laissez pas tromper aux mensonges de sa langue caressante : ce qu’il vous dit, il me l’avait dit avant. » (Sapho à Phaon, 41-56)
Des lettres ardentes et désespérées, de trahison et de vengeance, de passion et de douleur, de désir, de jalousie, de colère, d’humour aussi, qui décrivent la souffrance amoureuse et les émotions qu’elle fait naître.
Magnifique !
Bernard DELCORD
Héroïdes par Ovide, édition bilingue, texte établi par Henri Bornecque et traduit du latin par Marcel Prévost, édition revue par Danielle Porte, introduction et notes d’Adrian Faure, Paris, Éditions Les Belles Lettres, collection « Classiques en poche » dirigée par Hélène Monsacré, avril 2024, 417 pp. en noir et blanc au format 11 x 18 cm sous couverture brochée en couleurs, 14,90 € (prix France)
[1] Son surnom « Naso » lui est venu de son nez proéminent.
[2] En grec et en latin, couple de deux vers formé d’un hexamètre (six syllabes) et d’un pentamètre (cinq syllabes).
[3] Dactyle : dans la poésie grecque et latine, rythme composé de trois syllabes, une longue accentuée suivie de deux brèves.
[4] Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovide